Très jeune, il découvre que, seul dans son entourage, il a accès à un monde qu'il qualifiera plus tard de "suprasensible". Il se trouve donc dans la situation de devoir acquérir simultanément la connaissance de deux mondes dont l'interdépendance obéit à des lois que, sa vie durant, il exploitera méthodiquement, pour proposer aux hommes une voie de connaissance scientifique d'un domaine qui n'est généralement pas considéré comme relevant de la science.
Ses études et travaux dans les sciences et la philosophie le font, très jeune, remarquer par les cercles savants de Vienne et d'Allemagne. On lui confie la publication commentée des oeuvres scientifiques de Goethe, à Weimar, entre 1885 et 1890.
Rudolf Steiner soutient en 1891 une thèse de doctorat en philosophie : "Vérité et Science"(**), théorie de la connaissance qu'il élargira en 1894 dans une oeuvre majeure : "La Philosophie de la Liberté" (***).
A Berlin, grâce à ses travaux sur Goethe et sur Nietzsche, il occupe une place importante dans la vie culturelle, il est conduit à s'intéresser aux besoins culturels et aux aspirations sociales du monde ouvrier. Il est appelé à enseigner à l'Université populaire, mais sa liberté d'esprit se heurte rapidement au dogmatisme des dirigeants de cette institution.
Si ces recherches, avant 1914, sont essentiellement consacrées à l'histoire du monde et de ses civilisations, et à l'homme lui-même dans sa triple nature physique, psychique et spirituelle, le drame de la première guerre mondiale oriente son activité vers une analyse très profonde des causes spirituelles et sociales qui y ont conduit. Causes qui ont aussi conduit à la révolution d'octobre 1917 et engendreront la deuxième guerre mondiale. Il élabore une sociologie pratique (une économie sociale) fondée sur sa connaissance de la nature humaine. Mais, entre 1919 et 1922, dans l'Allemagne vaincue, les forces morales et la liberté d'esprit nécessaires pour mettre en œuvre ses idées ne sont pas présentes. Avant que le nazisme ne submerge le monde allemand et l'Europe, il oriente toute sa capacité de renouvellement et d'élargissement des connaissances vers la pédagogie, et aussi la médecine, la pharmacologie, l'agriculture..., pour préparer l'avenir après le drame nouveau dont il pressent l'imminence.
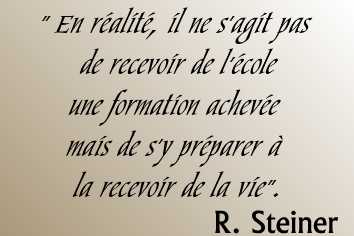 Dans les premières années du siècle, il a créé à Dornach, près de Bâle, l'Université Libre de Science de l'Esprit, à laquelle il donne le nom de ¨ Goetheanum¨. Il s'y installe à partir de 1914 pour y poursuivre son enseignement, et y meurt en 1925. La voie méthodique de connaissance ouverte par Rudolf Steiner porte le nom qu'il a lui-même choisi : ¨Anthroposophie¨.
Dans les premières années du siècle, il a créé à Dornach, près de Bâle, l'Université Libre de Science de l'Esprit, à laquelle il donne le nom de ¨ Goetheanum¨. Il s'y installe à partir de 1914 pour y poursuivre son enseignement, et y meurt en 1925. La voie méthodique de connaissance ouverte par Rudolf Steiner porte le nom qu'il a lui-même choisi : ¨Anthroposophie¨.Des nombreuses voies de recherche, décrites par Steiner dans ses livres (une trentaine d'ouvrages) et ses conférences (environ six mille) sont issues, dès 1919, des institutions s'inspirant de l'Anthroposophie, dans des domaines aussi variés que la pédagogie, la pédagogie curative (institutions pour enfants et adultes handicapés), la sociothérapie (visant notamment à la réinsertion des toxicomanes), la médecine et la pharmacologie (associations de médecin, hôpitaux, cliniques, laboratoires dans une quinzaine de pays), la méthode d'agriculture biologique-dynamique, des instituts de recherche fondamentale (universités libres, laboratoires) et des institutions fiduciaires et bancaires.
Dans le domaine pédagogique, après la fondation de la première école en 1919, à Stuttgart, dans le cadre de la fabrique de cigarettes Waldorf-Astoria, le mouvement s'étend en Allemagne et à l'étranger. Son interdiction par le régime nazi et les difficultés liées aux situations difficiles de la deuxième guerre mondiale stoppent ce développement jusqu'en 1945.
Après la guerre, la réouverture des établissements et le développement progressif du mouvement gagne toute l'Europe, et s'étend progressivement à tous les continents.
(*) Autobiographie, R. Steiner, Editions anthroposophiques romandes, Genève, 1979.
Une biographie de R. Steiner, G. et P.-H. Bideau, Novalis éditeur, Montesson, 1997.
(**) Vérité et Sciences, Editions anthroposophiques romandes, Genève, 1979.
(***) La philosophie de la liberté, Novalis éditeur, Montesson, 1993.
